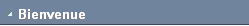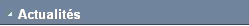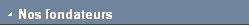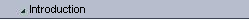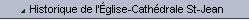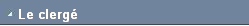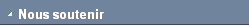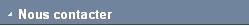La première montagne est celle du don et, plus précisément encore, du don de soi. Si nous admettons généralement que le don est une dimension essentielle de l’amour, nous oublions trop souvent cependant qu’il ne s’agit pas simplement de donner quelque chose, mais de se donner. Évidemment, il est vrai que l’amour est don de nos richesses et que nous ne saurions concevoir une relation d’amour sans offrir ce que l’on possède (matériellement, psychologiquement et spirituellement). Comment pourrions-nous envisager, à plus forte raison, un rapport amoureux où chacun conserverait son compte en banque et ses propres ressources, demandant à l’autre de contribuer équitablement aux achats en commun ? Mais il y a un don encore plus fondamental sans lequel il n’y a pas de vrai amour. C’est le don de soi à la manière dont les époux s’offrent mutuellement l’un à l’autre au point de ne plus s’appartenir, au point d’être dépossédés d’eux-mêmes.
Ainsi, il nous faut apprendre ici à nous donner sans réserve, sachant que la joie de donner est souvent plus grande que celle de recevoir. En fait, « l’homme amoureux, qui cherche à se réaliser dans le don à celle qu’il aime, la mère de famille qui se donne à ses enfants et ne vit que pour eux, sont capables de comprendre ces mots-là. Parce qu’ils communient autant qu’il est possible au mystère de notre Dieu, source de tout amour. » (Ferlay, Philippe, Dieu Trinité dans notre vie, Nouvelle Cité, Paris, 1985). Nous sommes donc invités à donner sans réserve nos propres biens, mais aussi à nous donner nous-mêmes, faisant de notre être tout entier une véritable oblation. Sur un plan plus mystique, c’est d’ailleurs la symbolique profonde de l’offertoire, un moment de la messe qui en demeure certainement l’un des plus grands. Dès le début, il fut pour moi, et il le demeure toujours aujourd’hui, le passage le plus émouvant de la messe, y ayant découvert ce que signifiait vraiment l’offrande de soi, quelque chose que je n’avais encore jamais imaginé.
La deuxième montagne à gravir correspond au développement d’une aptitude à accueillir pleinement l’autre. D’ailleurs, « il n’y a pas d’amour à prendre, tandis qu’il y a de l’amour à accueillir. Il y a autant d’amour à accueillir qu’à donner... » (Varillon, François, Joie de croire, joie de vivre, Éditions du Centurion, Paris, 1981, p. 28). L’accueil est alors plus qu’une simple reconnaissance de l’autre. En effet, il s’agit d’une attitude visant à nous centrer sur lui afin de lui accorder une place prépondérante au sein de notre vie, une place centrale. Dans ce but, nous sommes évidemment invités, dans un premier temps, à nous décentrer. En effet, « je me décentre afin de n’être plus à moi-même mon propre centre, mais que désormais mon centre soit toi. C’est toi que j’aime, qui es mon centre, je vis pour toi et par toi... Aimer, c’est renoncer à vivre en soi, pour soi et par soi. » (Varillon, François, Joie de croire, joie de vivre, Éditions du Centurion, Paris, 1981, p. 28). Ainsi, l’accueil de l’autre s’amorce toujours dans un mouvement grâce auquel nous nous retirons de nous-mêmes en nous-mêmes pour générer un espace vide, invitant alors l’autre à devenir le centre de notre propre vie.
De cette attitude découle une certaine dépendance par rapport à l’autre, notre existence étant désormais centrée sur lui. « Essayons en ce sens d’imaginer le regard d’amour d’une femme sur son mari où il n’y aurait que de l’amour et procédons par l’absurde. Cette femme peut-elle dire à son mari : je t’aime, mais il est bien entendu que si ta situation t’appelle à Madagascar, moi, je reste en France ? Autrement dit, en même temps que je t’exprime mon amour, je t’affirme mon indépendance par rapport à toi. Il est évident qu’une telle attitude est impossible. Aimer, c’est vouloir dépendre: je t’aime, je te suivrai jusqu’au bout du monde, je veux dépendre de toi. » (Varillon, François, Joie de croire, joie de vivre, Éditions du Centurion, Paris, 1981, p. 30).
Cette dépendance ne s’inscrit toutefois pas dans une perspective égoïque, car elle n’est pas soumise à la nécessité de recevoir quoi que ce soit de l’autre. Le Père Varillon l’a d’ailleurs très bien exposé en prenant l’exemple de la relation de dépendance liant l’enfant à sa mère : « Faisons donc attention à une ambiguïté qu’il faut réduire, car il y a deux sortes de dépendance : est-ce bébé qui dépend de maman ou maman qui dépend de bébé ? Au plan de l’être et de la vie, c’est l’enfant qui dépend de sa mère, mais au plan de l’amour, n’est-ce pas la mère qui dépend de l’enfant ? La dépendance de l’enfant par rapport à sa mère est étrangère à l’amour, à la liberté. Si maman n’est pas là pour lui donner le sein, il aura faim, bien sûr. Mais, dans l’amour, c’est la mère qui dépend de son enfant, c’est à ce moment qu’elle lui dit : tu es toute ma joie. Et si l’enfant respire mal, s’il est malade, si le médecin est inquiet, maman ne vit plus, tellement elle dépend de son enfant. » (Varillon, François, Joie de croire, joie de vivre, Éditions du Centurion, Paris, 1981, p. 31).
La troisième montagne à gravir correspond à une expérience de participation à la nature de l’autre, l’ultime désir de toute expérience amoureuse étant de pouvoir ressentir ce que l’autre ressent, de pouvoir vivre ce qu’il vit, et de pouvoir participer pleinement à sa réalité. Toute personne qui a vraiment aimé sait ce que cela représente, la plus grande souffrance de l’amour étant de demeurer étranger à l’autre, de ne pas pouvoir faire son expérience. Or l’accueil et le don, au sens où nous venons de les définir, nous amènent à participer à la réalité de l’être aimé, puisque nous en faisons le centre de notre vie et que nous nous offrons à lui. La plénitude de l’amour nous conduit alors à une expérience de transcendance qui permet d’aller au-delà de ce que nous sommes, dans une participation sans confusion.
En effet, « le voeu de l’amour est de devenir l’autre, tout en restant moi, de telle sorte que l’autre et moi, nous ne soyons pas seulement unis mais que nous soyons véritablement un. L’expérience humaine de l’amour est joie et souffrance mêlées. Joie prodigieuse de dire à celui ou à celle que l’on aime : toi et moi, nous ne sommes pas deux, mais un. Souffrance d’être obligés de reconnaître qu’en disant cela, on dit, non pas ce qui est, mais ce que l’on voudrait qui soit et qui ne peut pas être. Car si l’aimant et l’aimé n’étaient plus deux, il n’y aurait plus d’autres, et, du coup, l’amour serait aboli. Comme disent les braves gens, pour aimer, il faut être deux. Écoutez dialoguer deux personnages de Gabriel Marcel dans Le coeur des autres : "Toi et moi, dit Daniel à sa femme, nous ne sommes pas deux." Sa femme, qui est une fine mouche, répond : "C’est justement ce qui m’effraie quelquefois; tu n’as jamais l’air de me considérer comme quelqu’un d’autre. Quand on n’est plus qu’un seul... comment t’expliquer cela ? On ne se donne plus rien... Et c’est terrible, parce que cela peut devenir un prétexte pour ne penser plus qu’à soi." Si toi et moi, nous ne faisons qu’un, nous nous aimons nous-mêmes. Mais l’amour de soi n’est pas l’amour, il est complaisance en soi, il n’est pas don ni accueil. » (Varillon, François, Joie de croire, joie de vivre, Éditions du Centurion, Paris, 1981, pp. 138-139).
Toute expérience humaine de l’amour tend donc à cette communion sans confusion et il serait erroné d’affirmer, à la manière de Platon, que l’amour s’accomplit dans une fusion. Le philosophe ose même mettre dans la bouche du dieu forgeron cette proposition adressée aux amoureux : « N’est-ce pas ceci vraiment dont vous avez envie: vous identifier le plus possible l’un avec l’autre, de façon que, ni nuit, ni jour, vous ne vous délaissiez l’un l’autre ? Si c’est en effet de cela que vous avez envie, je peux bien vous fondre ensemble, vous réunir au souffle de ma forge, de telle sorte que, de deux comme vous êtes, vous deveniez un, et que, tant que durera votre vie, vous viviez l’un et l’autre en communauté comme ne faisant qu’un. ». S’il est vrai qu’en aimant quelqu’un, je me tourne tout entier vers lui en souhaitant de tout coeur le rejoindre dans ses pensées, dans ses joies, dans ses peines et dans son corps ; s’il est vrai que je choisis de porter sa vie alors qu’il porte la mienne, tout ceci n’implique cependant pas qu’il y ait fusion au sens où la distance et l’altérité disparaîtraient.